Rencontre avec… Pr Géraldine Lescaille
Chef du service de médecine bucco-dentairede l’Hôpital Pitié-Salpêtrière
Propos recueillis par Julien Biton - Ao NEws #72 - février 2025
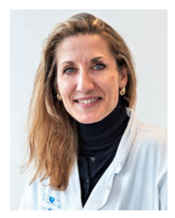
AON. La première question ne change jamais, qui est Géraldine Lescaille et quel est son parcours ?
Géraldine Lescaille. Je suis professeur des universités et praticien hospitalier depuis 2017, c’est-à-dire à la fois enseignant-chercheur et praticien avec un exercice spécialisé en chirurgie orale.
Au niveau régional, je suis également chef du service de médecine bucco-dentaire de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière (PSL) depuis 2022, présidente de la collégiale des services de chirurgie dentaire de l’APHP, vice-doyen stratégie et projet de l’UFR d’odontologie de l’Université Paris Cité, et coordonnatrice des internes de chirurgie orale en Ile de France. Au niveau national, je suis présidente du collège national des enseignants en chirurgie orale par intérim depuis peu et vice-présidente de la Société Française de Chirurgie Orale (SFCO).
Mon parcours a débuté par des études en odontologie en 1998, avec un cursus long car j’ai souhaité très tôt me spécialiser en médecine et chirurgie orales, et faire de la recherche en cancérologie. J’ai pu bénéficier d’une année recherche pendant l’internat (AEA) pour réaliser un master 2 portant sur les cancers oraux mais également suivre la formation du Diplôme d’Etudes Supérieures en Chirurgie Buccale (DESCB) pendant 4 ans puisque l’internat en chirurgie orale (DES) n’a été créé qu’en 2011. J’ai ensuite opté pour une carrière HU afin de pouvoir prendre en charge des patients nécessitant un recours hospitalier pour des lésions des mâchoires ou des muqueuses, tout en continuant mon activité de recherche et à faire de l’enseignement. Cette carrière a débuté en tant qu’AHU en 2007, puis MCU-PH à partir de septembre 2012 après l’obtention d’une thèse de doctorat d’université portant sur le développement de stratégies thérapeutiques d’immunothérapie dans les cancers oraux. J’ai ensuite poursuivi mes travaux de recherche jusqu’au diplôme d’habilitation à diriger des recherches (HDR) en 2016n, avant d’être nommée PU-PH.
AON. Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans le service de médecine bucco-dentaire ? Qu’est-ce qui vous à amener à poursuivre cette activité ? Avez-vous eu des mentors ?
G.L. J’ai débuté dans ce service en tant qu’étudiante et ne l’ai jamais complètement quitté. Passionnée par la chirurgie orale et fascinée par la recherche, j’ai eu la chance d’avoir différents mentors, des hommes et des femmes tout aussi passionnés et investis dans leurs missions hospitalières et/ou de recherche. C’est d’ailleurs grâce à eux que j’ai compris que la carrière HU était une évidence, en commençant par le passage par le concours de l’internat. Au sein de cette équipe dirigée d’abord par le Pr Azérad puis par le Pr Descroix, j’ai pu me former, notamment avec le Dr Rafael Toledo, et développer dès 2009 une consultation spécifique concernant les patients d’oncologie. J’ai ensuite organisé une équipe de chirurgie orale permettant de poursuivre mes projets de manière très fluide et cohérente.
AON. Quels ont été pour vous les principaux défis que vous avez rencontrés ?
G.L. Le cursus pour devenir PU-PH est long et pas toujours facile, mais je n’ai jamais regretté mon choix. Il y a tant à faire et la tâche est captivante !
Le principal défi a été de prendre la chefferie du service de médecine bucco-dentaire du service de PSL progressivement entre fin 2021 et officiellement en 2022. J’ai dû me former au management hospitalier, afin de prendre la suite de mon collègue et ami le Pr Vianney Descroix, qui devenait doyen de notre UFR, dans une période très spéciale correspondant à la création de l’UFR d’Odontologie parisienne unique, dans un service que j’ai connu à sa création en tant qu’étudiante de dernière année. Nous devions par ailleurs cette année-là accueillir et former pour la première dans le service les étudiants débutant de 2ème cycle alors qu’ils étaient auparavant accueillis dans le service de l’hôpital Rothschild.
Le challenge était très enthousiasmant, mais difficile à relever. J’ai beaucoup travaillé et peu dormi et j’ai eu la chance d’être soutenu par une formidable équipe, et d’être accompagné au jour le jour par mes deux chefs de service adjoint le Pr Yves Boucher (PUPH) et le Dr Samantha Elbhar (PH).
Aujourd’hui, plus qu’hier, je m’investis pour rendre visible l’odontologie hospitalière auprès de la communauté médicale et chirurgicale hospitalière des autres spécialités. Je cherche à articuler notre activité avec celle des chirurgiens-dentistes de ville pour les soins de recours. Il est absolument nécessaire de former de futurs praticiens de ville mais également des praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires, ainsi que du personnel paramédical adapté à l’odontologie hospitalière (assistante dentaire niveau 1 et 2, prothésistes).
Ceci va de pair avec une implication dans le challenge des réformes universitaires en cours, en appuyant la défense de l’internat en odontologie, indissociable du maintien des soins de recours hospitalier, fondé sur les différentes spécialités dont la chirurgie orale, et de travailler sur l’amélioration de l’offre de soins sur le territoire.
AON. Comment décririez-vous la dynamique pluridisciplinaire de votre service et quelles spécialités y sont présentes ?
G.L. Nous proposons tous les types de soins bucco-dentaires dans notre service, que ce soient l’orthodontie, la parodontie, l’odontologie restauratrice, l’endodontie, la réhabilitation prothétique, la chirurgie orale sous toutes ces formes y compris implantaire et pré-implantaire. PSL est dédié principalement aux adultes, mais reçoit néanmoins des enfants dans le cadre de l’orthodontie et des urgences bucco-dentaires quand les autres services de l’APHP sont fermés.
Nous disposons de deux unités fonctionnelles (UF) depuis la création du service, celle des urgences bucco-dentaires qui assure nuit et jour plus de 50 000 passages par an, et celle de la PASS qui accueille les patients en situation de renoncement aux soins pour des raisons financières.
La grande majorité de nos patients sont adressés par les autres services ou par la ville, car ils nécessitent une approche hospitalière le plus souvent multidisciplinaire. Ils sont référés principalement du fait de leurs comorbidités (risques hémorragiques, infectieux, voir vitaux) ou du fait de la complexité de leur cas nécessitant une approche spécifique spécialisée : réhabilitation sur des pertes de substances des mâchoires, maladies rares avec répercussions oro-faciales, pathologies des mâchoires ou des muqueuses, douleurs oro-faciales chroniques, difficulté et complexité opératoire (implants zygomatiques, dents incluses etc..) ou d’anesthésie générale (notamment handicap sévère).
Nous avons la possibilité depuis début 2024 d’accueillir au sein du service nos patients en hôpital de jour (HDJ). Cette innovation s’ajoute à l’offre de soins préexistante et celle prendre en charge nos patients sous anesthésie générale 2 jours et demi par semaine au sein de l’UCA, un bâtiment commun à toutes les interventions des différentes spécialités chirurgicales réalisés en ambulatoire. Plus de 300 patients sont ainsi pris en charge en hospitalisation de jour soit du fait d’une intervention sous anesthésie générale ou pour organiser une surveillance post-opératoire et/ou organiser la perfusion de traitement (hémophiles notamment)/transfusion plaquettaire.
Ces efforts ont été récompensés par la place au classement national 2024 du magazine Le Point qui a placé notre service 4ème pour la CHIRURGIE DENTAIRE ET ORALE de l’adulte sur 30 hôpitaux alors que nous étions 15èmes en 2021. Nous pouvons être fiers de notre équipe, et cela laisse encore une petite marge de progression…
AON. A l’ouverture de votre service en 2002, le but était de prendre en charge les patients précaires et les urgences. Depuis l’évolution n’a cessé de progresser, en nombre de praticiens, en spécialité, en recherche, quels sont les facteurs qui ont permis cette transformation ?
G.L. Notre activité a nettement progressé. L’équipe, initialement constituée de 3 praticiens temps plein et quelques étudiants occupant une vingtaine de fauteuils comprend aujourd’hui 20 titulaires HU, 18 HU contractuels, 3 PH titulaires, 10 praticiens hospitaliers contractuels, 84 étudiants de 2ème cycle, 64 de 3ème cycle dont 33 étudiants en 6ème année, le reste étant des internes ainsi qu’une trentaine d’étudiants en formation clinique continue (DU FARIO en implantologie, DU d’orthodontie linguale, DU d’endodontie). Nous disposons par ailleurs aujourd’hui de 63 fauteuils de soins, et 7 blocs de chirurgie orale sous anesthésie locale.
L’élément initial de cette croissance a été la fermeture du CSERD (Centre de soins d’enseignement et de recherche) de Garancière rattaché historiquement à l’hôtel Dieu de l’APHP, qui s’est accompagné du transfert de l’offre de soin sur les sites de l’hôpital Rothschild et de la Pitié-Salpêtrière en 2011. A cet évènement fondateur s’est ajouté la mise en place de l’internat qualifiant en 2011 : la création des DES d’ODF, de MBD et de CO, a permis d’accueillir de nombreux internes sur le site PSL.
Plus récemment, en 2021, la création de l’UFR parisienne, résultant de la fusion des 2 facultés historiques, s’est accompagné d’une répartition des étudiants de toutes les années sur l’ensemble des 6 sites hospitaliers (2 sites de l’AP-HP GH nord, Bretonneau et Louis Mourier, les 3 sites de l’AP-HP Sorbonne-Universités RTH, PSL et Charles Foix, ainsi que Henri Mondor). Notre équipe de praticiens H et HU est jeune, dynamique, avec une très forte énergie au service des patients et de la formation des étudiants. Parmi les éléments d’attractivité rapportés par nos praticiens, la possibilité de suivre des cas complexes hospitaliers, de travailler en équipe, de poursuivre sa formation, d’être au contact des étudiants et pour les HU plus particulièrement de pouvoir avoir une activité de recherche en cohérence avec leur activité clinique, sont les plus rapportés.
Nous avons en effet de nombreux projets de recherche clinique et transversaux avec différentes équipes, la plupart labellisées Inserm et/ou CNRS et notamment avec la nouvelle Unité Mixte de Recherche de l’UFR de l’Université Paris Cité dédiée à la santé orale (UMR 1333). Nos principales thématiques au sein du service concernent les maladies rares oro-faciales, les douleurs oro-faciales, la reconstruction tissulaire oro-faciale, l’ingénierie numérique et la réhabilitation orale, la santé publique et l’épidémiologie ainsi que l’oncologie.
Enfin, dans le cadre d’une restructuration de l’activité chirurgicale au sein de l’hôpital Pitié Salpêtrière achevée en 2023, le service de médecine bucco-dentaire s’est séparé du service de chirurgie maxillo-faciale avec lequel il cohabitait depuis l’ouverture de notre service. Nous avons alors rebaptisé le bâtiment de stomatologie en Institut de Chirurgie-Dentaire (ICD), que nous occupons aujourd’hui. Ceci nous donne la possibilité de mieux organiser nos activités, et notamment de déployer avec succès notre HDJ (hospitalisation de jour).
AON. Votre service joue un rôle fondamental dans la formation des étudiants. Quelles valeurs ou compétences cherchez-vous à transmettre aux futurs praticiens ?
G.L. Les étudiants débutent leur formation clinique dès le début de la 4ème année, mais les étudiants en 2ème et 3ème année viennent suivre des vacations cliniques dès le 1er cycle pour se familiariser avec l’activité professionnelle de chirurgien-dentiste en parallèle de leur formation pré-clinique sur simulateur. Cela leur permet de mieux appréhender le début du 2ème cycle, et de passer du simulateur au patient avec plus en confiance. En dehors de leur formation aux gestes procéduraux, la formation aux compétences non procédurales est fondamentale pour que les étudiants deviennent des professionnels médicaux à part entière. Outre les aspects techniques et chirurgicaux, les règles éthiques essentielles du respect du patient et du secret médical sont enseignées ainsi que le respect de la déontologie professionnelle.
La formation des étudiants est assurée par des praticiens hospitalo-universitaire et hospitaliers qui accompagnent et contrôlent l’évolution progressive de leur autonomie. Le milieu hospitalier leur permet de mieux comprendre la formation médicale en prenant en charge des patients présentant des comorbidités, et d’identifier la notion de soins de recours. Ils travaillent en équipe avec des internes en cours de spécialisation, et des seniors.
Enfin, nous avons plusieurs formations continues de l’Université Paris Cité comportant des stages cliniques : le DU FARIO pour la réhabilitation implantaire orale, le DU d’endodontie, et le DU d’orthodontie linguale. Nous prévoyons plusieurs nouveaux DU pour la rentrée 25, mais suspense, je n’en dis pas plus !
AON. Comment voyez-vous l’avenir de l’odontologie hospitalière dans un environnement en constante évolution ?
G.L. Un constat tout d’abord : depuis 30 ans, l’évolution de notre profession au sein de l’hôpital a été considérable, et ce au bénéfice des patients et de la formation de nos futurs praticiens.
Je distingue plusieurs éléments marquants :
- l’intégration des services d’odontologie dans les hôpitaux au même titre que les autres spécialités médicales, accompagnée d’une mutation complète de l’offre de soin ;
- la mise en place de l’internat en odontologie, et en particulier la création de la spécialité de chirurgie orale en 2011, conduisant au développement d’unités et de services de chirurgie orale remplaçant progressivement la stomatologie ;
- la création de postes de praticiens hospitaliers dans nos services de CHU ;
- la transformation des carrières hospitalo-universitaires avec la formation de praticiens enseignants-chercheurs ayant à la fois une activité clinique et de recherche spécialisée orientée vers des cohortes de patients spécifiques. Cela favorise la création d’équipes de praticiens avec des chefs de clinique junior, et permet de répondre à la fois à notre rôle de formation, de soin et de recherche. Cela a permis enfin une harmonisation de nos statuts très récemment avec la médecine et la pharmacie.
Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire et l’équilibre est précaire. Quelques exemples :
- le nombre de postes de PH par exemple est très faible. Nous devons pouvoir proposer de nouveaux types de postes universitaires sur des formats à mi-temps pour renforcer nos équipes HU ;
- notre personnel paramédical n’est souvent pas adapté, et bien que nous ayons des assistantes dentaires dans une très grande majorité de nos services, leur nombre n’est pas suffisant, car ce métier n’est pas reconnu à l’hôpital public. Il est donc nécessaire d’ouvrir des voies de formation spécifique répondant à nos besoins, en créant des postes d’assistant dentaire hospitalier, comme il y a des préparateurs en pharmacie hospitaliers.
- la valorisation des actes dans le service public est compliquée, avec des outils non adaptés et une absence de représentation hospitalière aux tables des négociations conventionnelles, ce qui impacte lourdement nos équipes.
Il est donc important que tous les acteurs de la profession échangent et s’entraident pour que l’offre de soins perdure et continue à se développer dans nos hôpitaux. Les premiers bénéficiaires seront bien évidemment les patients mais cela permettra également une formation des futurs praticiens dans les meilleures conditions, en poursuivant le développement de la recherche et de l’innovation, et en développant de nouveaux éléments d’attractivité pour les carrières H et HU.
AON. Votre service accueille un grand nombre de patients chaque année, combien de patients passent par vos urgences et vos services et comment gérez-vous cette affluence ?
G.L. : Notre service est le seul des 6 services de l’AP-HP à ne jamais fermer. Nous sommes ouverts 24h/24 et le flux des urgences est constant, avec environ 50 000 passages par an.
La journée en semaine et le samedi matin, notre service assure seul l’accueil des urgences, mais adresse les mineurs de moins de 15 ans vers d’autres sites hospitaliers notamment sur le site de RTH, sauf pendant les périodes de fermeture. La nuit, de 18h30 à 8h30, le samedi après-midi à partir de 13h30, et le dimanche et les jours fériés, la permanence des soins est assurée sur le site PSL par un senior, un interne et un externe de 6ème année (demi-garde la nuit) d’un des 6 services de l’APHP.
Notre vocation première est de prendre en charge les vraies urgences hospitalières, c’est-à-dire les hémorragies, les traumatismes, et les cellulites cervico-faciales. Néanmoins, à chaque période de congés, nous observons des hausses très importantes du nombre de patients en lien avec la fermeture de l’offre de soin de ville, pour des motifs de douleurs dentaires notamment. Les pics de passage dépassent 250 patients/jour, notamment les dimanches et jours fériés et pendant l’été, alors que l’équipe médicale est réduite. Cela est très problématique !
Outre l’épuisement des équipes hospitalières qui pallient le manque d’offre de soin, cela entraîne un allongement très important du temps d’attente et une grande difficulté à maintenir la qualité de la prise en charge. Cela souligne l’importance d’un travail collaboratif avec la ville. Nous avions déjà travaillé avec le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes lors de l’épidémie de COVID où seuls les services hospitaliers sont restés ouverts pendant de longues semaines du fait notamment du manque d’EPI. J’avais mis en place à l’époque, avec l’ensemble des services, le COVIDENT. Pendant la période des JO 24, grâce à l’ARS Ile de France et au Conseil de l’Ordre et s’appuyant sur l’expérience de la COVID, nous avons pu anticiper sereinement cette période, en veillant à ce qu’un nombre suffisant de cabinets en ville restent ouverts, et que les pharmacies puissent aider à la régulation des urgences dentaires entre la ville et l’hôpital. Nous avons élaboré des fiches d’orientation permettant un tri efficace sur des éléments spécifiques. Un travail est également en cours sur une optimisation de la permanence des soins de ville afin d’éviter de surcharger les urgences hospitalières. Un début de diminution du flux est observé depuis quelques années et nous espérons encore dans les prochaines années réduire le flux des patients présentant une urgence relative sans nécessité de recours hospitalier.
AON. Votre service est un centre de compétences ORARE pour les maladies rares et collabore avec la plateforme handiconsult. Pouvez-vous nous expliquer comment vous adaptez la prise en charge de ces patients souvent difficiles à gérer au sein des cabinets de ville ?
G.L. Nous sommes un centre de compétences maladies rares ORARE, rattaché au centre de référence de l’hôpital Rothschild. Notre rôle est de diagnostiquer et de prendre en charge les patients atteints de maladies rares avec une répercussion bucco-dentaire nécessitant des soins adaptés. Il s’agit par exemple de suite de séquelles de fentes, d’amélogénèse ou dentinogénèse imparfaite, de syndromes génétiques avec des malformations bucco-dentaires, ou de patients de centres de maladies rares nécessitant une prise en charge hospitalière compte tenu des risques en lien avec les soins notamment lorsqu’ils sont invasifs (Hémophilie, Dermatoses bulleuses, Ehler-Danlos, Sclérodermies etc…). Nous travaillons par ailleurs avec la plateforme handiconsult de l’hôpital et avec l’hôpital Necker, pour la prise de patients présentant un ou des handicaps sévères ne permettant pas une prise en charge de ville et nécessitant notamment une anesthésie générale.
Les différentes spécialités odontologiques travaillent ensemble pour le bénéfice des patients nécessitant un recours hospitalier et leur expérience est déterminante pour le traitement des cas complexes. Les orthodontistes de notre service par exemple interviennent sur de nombreux patients présentant des maladies rares avec des répercussions malformatives nécessitant une prise en charge multidisciplinaire impliquant les internes des trois filières et d’autres spécialités chirurgicales telles que la CMF et l’ORL.
Nous prenons en charge les patients à besoins spécifiques de l’ensemble des autres services du groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière et souvent d’autres hôpitaux nécessitant une prise en charge adaptée, notamment bilan et élimination des foyers infectieux en aigüe ou avant de débuter un traitement, réhabilitation en prothèse maxillo-faciale pour les patients ayant un ATCD oncologique, soins des patients hospitalisés de longue durée…
AON. Y-a-t-il un système, une plateforme pour le praticien libéral afin de vous adresser des patients simplement ?
G.L. C’est un point difficile du fait d’un secrétariat médical insuffisamment dimensionné par rapport aux besoins du service, et que nous ne maîtrisons malheureusement pas. Nous fonctionnons pour le moment avec un formulaire en ligne permettant aux patients de déposer le courrier réalisé par le praticien qui nous adresse le patient. Nous répondons également par mail aux praticiens qui nous contactent. Nous souhaitons déployer rapidement un système de téléexpertise, notamment pour les patients présentant des lésions de la muqueuse ou des images radiologiques inhabituelles, ou pour évaluer la nécessité d’un recours hospitalier selon une pathologie ou un traitement. Cela permettra de faciliter les échanges dans un cadre médical et juridique.
AON. Enfin, quels messages souhaiteriez-vous transmettre à nos confrères suite à votre expérience et votre engagement au sein de ce service ?
G.L. L’amélioration de la santé orale des patients est un problème de santé publique et un défi médical majeur que nous devons relever. La formation initiale des étudiants et la formation continue des praticiens sont des éléments-clés. L’articulation des soins entre la ville et l’hôpital est une nécessité. Nous devons coordonner et adapter l’offre de soins proposée par les chirurgiens-dentistes de ville référents et les spécialistes hospitaliers. Seule cette coordination effective permettra une prise en charge optimisée des patients, du diagnostic des pathologies oro-faciales à la réhabilitation bucco-dentaire, en prenant en compte la prévention.
